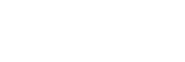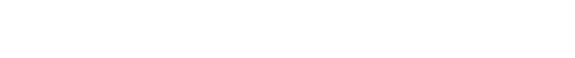- DÉCOUVREZ
-
INTERROGEZ
- BOUTEILLES À BOISSONS ALCOOLISÉES
- CÉRAMIQUES EURO-AMÉRICAINES
- PIPES EN PIERRE DE LA PÉRIODE HISTORIQUE
- POINTES DE PROJECTILES
- PIPES EN TERRE CUITE
- MONNAIES ET JETONS
- CÉRAMIQUES DU SYLVICOLE INFÉRIEUR ET MOYEN
- CÉRAMIQUES DU SYLVICOLE SUPÉRIEUR
- PERLES DE VERRE
- FAÏENCES
- FORT DE VILLE-MARIE
- PALAIS DE L'INTENDANT
- ÉPAVE DU ELIZABETH & MARY
- BAGUES DITES « JÉSUITES »
- LES BASQUES EN AMÉRIQUE DU NORD
- LE PALÉOINDIEN
- ARCHÉOLOGIE DE L'ENFANCE
- CARTIER-ROBERVAL
- SUR LES TRACES DE CHAMPLAIN
- MISSIONS
- FORTS MILITAIRES FRANÇAIS
- SITE DE LA POINTE-DU-BUISSON
- PRÉHISTOIRE À PLACE-ROYALE À QUÉBEC
- PÉRIODE PALEO-INUITE AU NUNAVIK
- PÉRIODE INUITE AU NUNAVIK
- PARLEMENT DE LA PROVINCE DU CANADA
- LES POSTES DE TRAITE
- L'ARCHAIQUE
- LE SYLVICOLE SUPÉRIEUR
- PEUPLES DE LA CÔTE-NORD
- BRASSERIES ET DISTILLERIES
- CORPS DE MÉTIER: ATELIER DU FORGERON
- CABINET DE L'APOTHICAIRE
- CORPS DE MÉTIER: TRAVAIL DU CUIR
- RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES : LES AUGUSTINES DE QUÉBEC
- OUTILLAGE EN OS
- CONTENANTS DE CONDIMENTS
- CORPS DE MÉTIER: ATELIER DU POTIER ET DU PIPIER
- QUINCAILLERIE D'ARCHITECTURE
- LA CÉRAMIQUE DU XIXe SIÈCLE À HEDLEY LODGE
- LES CAMPS DE BUCHERONS
- LE POSTE DE LA REINE
- LE PREMIER MARCHÉ SAINTE_ANNE (1834-1844)
- LA TAILLE DE LA PIERRE
- EN COULISSE
-
- À PROPOS
- PLAN DU SITE

Coquetier. Vue générale

Photo : Mathieu Landry 2023, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
Collections archéologiques de la Ville de Québec
Collections archéologiques de la Ville de Québec
Coquetier. Profil

Photo : Mathieu Landry 2023, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
Collections archéologiques de la Ville de Québec
Collections archéologiques de la Ville de Québec
Coquetier. Dessus

Photo : Mathieu Landry 2023, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
Collections archéologiques de la Ville de Québec
Collections archéologiques de la Ville de Québec
Coquetier. Dessous

Photo : Mathieu Landry 2023, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
Collections archéologiques de la Ville de Québec
Collections archéologiques de la Ville de Québec




PROVENANCE ARCHÉOLOGIQUE+
Provenance archéologique
CeEt-950 > Opération 3 > Sous-opération A > Lot 26
Contexte(s) archéologique(s)
Latrines
ÉVALUATION D'INVENTAIRE+
Le coquetier a été sélectionné pour la collection archéologique de référence du Québec, car il est représentatif d'un article faisant partie d'un ensemble à déjeuner. Également, il témoigne de la montée en popularité des coquetiers au sein de la classe moyenne durant le XIXe siècle.
SYNTHÈSES ET RÉFÉRENCES+
Synthèse historique
Le coquetier est fabriqué en terre cuite fine blanche au XIXe siècle, probablement en Angleterre. Alors que plusieurs articles en céramique ayant des usages spécifiques (vase à céleri, plat pour asperges) font leur apparition au cours du XIXe siècle, le coquetier est déjà en circulation depuis plusieurs siècles – un coquetier en argent a d'ailleurs été retrouvé dans les ruines de Pompéi. Au XVIIe siècle, les coquetiers sont principalement produits dans divers métaux, et possiblement en bois. Ceux en céramique auraient fait leur apparition au cours du XVIIIe siècle, avant de connaitre une hausse de popularité et de devenir plus accessibles à la classe moyenne durant la période victorienne. Selon les catalogues Eaton du dernier quart du XIXe siècle, les coquetiers sont alors vendus en ensembles de quatre, de six ou de douze coquetiers, et ils peuvent être vendus séparément ou faire partie d'un ensemble à petit déjeuner. Ils présentent principalement des décors imprimés, simples ou complexes, ou sont rehaussés de dorure. Celui-ci est d'ailleurs orné d'une double bande vert foncé imprimée près du rebord, d'une bande unique sur le pourtour du pied, ainsi que d'une fine bande près du rebord intérieur du coquetier. D'après le contexte de sa découverte, ce coquetier fait partie d'un ensemble de quatre.
Le coquetier est un article utilisé pour le service et la consommation d'oeufs cuits. D'après le contexte de sa découverte, il serait utilisé par Charles Théodore Pitl (vers 1834-1897) et sa famille. D'origine allemande, Pitl s'installe à Québec au début des années 1860 et loue à la famille Anderson leur imposante demeure de Limoilou, Hedley Lodge, à partir de 1870. Nommé consul d'Allemagne pour la Ville de Québec en 1868, il garde ce titre diplomatique jusqu'à son décès en 1897. En parallèle de ses activités diplomatiques, Charles T. Pitl est marchand à Québec et importe une grande variété de produits, allant des boissons alcoolisées aux jouets d'enfants en passant par des cigares et du verre à vitre. Il réside à Hedley Lodge avec sa femme Marie-Elizabeth Mathilda Lemelin et leurs quatre enfants. Après son décès, ses deux enfants survivants quittent la résidence familiale.
Le coquetier est mis au jour en juin 2018 sur le site archéologique Anderson, situé dans la ville de Québec. Le site doit son nom au grand propriétaire terrien Anthony Anderson, qui y fait construire Hedley Lodge au début du XIXe siècle. Son fils Horatio Smith Anderson y demeure de 1847 jusqu'à sa mort en 1867. Après le décès de Charles Pitl en 1897, la propriété connait plusieurs propriétaires et locataires au cours du XXe siècle, jusqu'à sa démolition vers 1970. Le site est alors converti en stationnement et devient le lieu du chantier-école en archéologie de l'Université Laval de 2017 à 2019.
Le coquetier a été découvert dans une fosse de latrines construite en 1850 par Horatio Anderson. Quoique ce coquetier-ci provienne d'un lot stratigraphique à la frontière entre le dépôt de la famille Anderson et celui de la famille Pitl, la présence de coquetiers identiques dans un lot supérieur indiquerait un rejet de cet ensemble à déjeuner par le consul d'Allemagne et marchand Charles Théodore Pitl plutôt que par Horatio Anderson. Trois autres coquetiers identiques à celui-ci ont été retrouvés dans la fosse, formant un ensemble de quatre. De plus, la présence de tasses et autres articles de vaisselle présentant cette même bande verte dans la collection Anderson indiquerait l'utilisation au sein de Hedley Lodge d'un ensemble assorti pour le déjeuner. Cet ensemble serait composé initialement d'une cafetière ou théière, de tasses, de soucoupes et de pièces plus spécifiques telles que des plats, des assiettes à déjeuner et des coquetiers. La fosse des latrines est ensuite fermée à la fin du XIXe siècle, alors que la demeure continue d'être occupée jusqu'à sa démolition à la fin des années 1960.
Le coquetier est un article utilisé pour le service et la consommation d'oeufs cuits. D'après le contexte de sa découverte, il serait utilisé par Charles Théodore Pitl (vers 1834-1897) et sa famille. D'origine allemande, Pitl s'installe à Québec au début des années 1860 et loue à la famille Anderson leur imposante demeure de Limoilou, Hedley Lodge, à partir de 1870. Nommé consul d'Allemagne pour la Ville de Québec en 1868, il garde ce titre diplomatique jusqu'à son décès en 1897. En parallèle de ses activités diplomatiques, Charles T. Pitl est marchand à Québec et importe une grande variété de produits, allant des boissons alcoolisées aux jouets d'enfants en passant par des cigares et du verre à vitre. Il réside à Hedley Lodge avec sa femme Marie-Elizabeth Mathilda Lemelin et leurs quatre enfants. Après son décès, ses deux enfants survivants quittent la résidence familiale.
Le coquetier est mis au jour en juin 2018 sur le site archéologique Anderson, situé dans la ville de Québec. Le site doit son nom au grand propriétaire terrien Anthony Anderson, qui y fait construire Hedley Lodge au début du XIXe siècle. Son fils Horatio Smith Anderson y demeure de 1847 jusqu'à sa mort en 1867. Après le décès de Charles Pitl en 1897, la propriété connait plusieurs propriétaires et locataires au cours du XXe siècle, jusqu'à sa démolition vers 1970. Le site est alors converti en stationnement et devient le lieu du chantier-école en archéologie de l'Université Laval de 2017 à 2019.
Le coquetier a été découvert dans une fosse de latrines construite en 1850 par Horatio Anderson. Quoique ce coquetier-ci provienne d'un lot stratigraphique à la frontière entre le dépôt de la famille Anderson et celui de la famille Pitl, la présence de coquetiers identiques dans un lot supérieur indiquerait un rejet de cet ensemble à déjeuner par le consul d'Allemagne et marchand Charles Théodore Pitl plutôt que par Horatio Anderson. Trois autres coquetiers identiques à celui-ci ont été retrouvés dans la fosse, formant un ensemble de quatre. De plus, la présence de tasses et autres articles de vaisselle présentant cette même bande verte dans la collection Anderson indiquerait l'utilisation au sein de Hedley Lodge d'un ensemble assorti pour le déjeuner. Cet ensemble serait composé initialement d'une cafetière ou théière, de tasses, de soucoupes et de pièces plus spécifiques telles que des plats, des assiettes à déjeuner et des coquetiers. La fosse des latrines est ensuite fermée à la fin du XIXe siècle, alors que la demeure continue d'être occupée jusqu'à sa démolition à la fin des années 1960.
RÉFÉRENCES
ARCHAMBAULT, Rachel, Serena HENDRICKX et Anne LABERGE. Le site Anderson (CeEt-950). Rapport d'intervention 2018 des opérations 3 et 4. Rapport de recherche archéologique [document inédit], Université Laval / Ville de Québec, 2019. 224 p.
BLANCHARD, Marine, Olivier GRATTON et Camille THÉRIAULT. Le site Anderson (CeEt-950). Rapport d'intervention des sous-opérations 5A, 5B et 6A, 2019. Rapport de recherche archéologique [document inédit], Université Laval / Ville de Québec, 2021. s.p.
LANTZ, Louise K. Old American Kitchenware 1725-1925. Camden, NJ ; New York, NY ; Hanover, PA, Thomas Nelson Inc./Everybodys Press, 1970. 289 p.
VOIR LA FICHE DU RÉPERTOIRE DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC 236350 

Coquetier
IDENTIFICATION+
Numéro(s)
Numéro archéologique : CeEt-950-3A26
Autres numéros
Numéro précédent : CeEt-950-3A25
Fonctions / usages
Le coquetier est un article à usage spécifique, c'est-à-dire utilisé pour le service et la consommation d'oeufs cuits.
Matériaux
Céramique - terre cuite fine (Blanche)
Classification(s)
Outils et équipement pour les matériaux > Alimentation : service et consommation des aliments
Lieu(x) de production
Présumé : Europe > Royaume-Uni > Angleterre
Dimensions
Diamètre de la base (Mesurée / intégral) : 4 cm
Diamètre du rebord (Mesurée / intégral) : 4,8 cm
Hauteur (Mesurée / intégral) : 6 cm
Technique(s) de fabrication :
Moulé
Cuit
Glaçure
Technique de décoration
Imprimé
Motif décoratif
Linéaire
Préhistoire/Histoire
historique
Période
Le Québec moderne (1867 à 1960)
Dates
Contexte archéologique : après 1870 - avant 1897
Découverte : 2018
DESCRIPTION+
Description
Le coquetier est un objet lié à l'alimentation datant du XIXe siècle. Entier, le coquetier en terre cuite fine blanche est constitué de trois fragments. Il présente un pied circulaire et plat, une très courte tige et une coupe ovale. Le coquetier est décoré de bandes de couleur vert foncé. L'objet mesure 6 cm de hauteur, a un diamètre de 4,8 cm à l'ouverture et un diamètre de 4 cm à la base.
Type de fabrication
Industriel
Intégrité
Objet entier constitué de plusieurs fragments recollés ou non (100% de l'objet)
Nombre de biens
1
Nombre de fragments
2
LIEU DE CONSERVATION+
NOM DE L'ORGANISME
Laboratoire d'archéologie de l'Université Laval