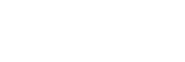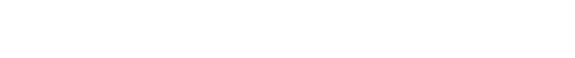- DÉCOUVREZ
-
INTERROGEZ
- BOUTEILLES À BOISSONS ALCOOLISÉES
- CÉRAMIQUES EURO-AMÉRICAINES
- PIPES EN PIERRE DE LA PÉRIODE HISTORIQUE
- POINTES DE PROJECTILES
- PIPES EN TERRE CUITE
- MONNAIES ET JETONS
- CÉRAMIQUES DU SYLVICOLE INFÉRIEUR ET MOYEN
- CÉRAMIQUES DU SYLVICOLE SUPÉRIEUR
- PERLES DE VERRE
- FAÏENCES
- FORT DE VILLE-MARIE
- PALAIS DE L'INTENDANT
- ÉPAVE DU ELIZABETH & MARY
- BAGUES DITES « JÉSUITES »
- LES BASQUES EN AMÉRIQUE DU NORD
- LE PALÉOINDIEN
- ARCHÉOLOGIE DE L'ENFANCE
- CARTIER-ROBERVAL
- SUR LES TRACES DE CHAMPLAIN
- MISSIONS
- FORTS MILITAIRES FRANÇAIS
- SITE DE LA POINTE-DU-BUISSON
- PRÉHISTOIRE À PLACE-ROYALE À QUÉBEC
- PÉRIODE PALEO-INUITE AU NUNAVIK
- PÉRIODE INUITE AU NUNAVIK
- PARLEMENT DE LA PROVINCE DU CANADA
- LES POSTES DE TRAITE
- L'ARCHAIQUE
- LE SYLVICOLE SUPÉRIEUR
- PEUPLES DE LA CÔTE-NORD
- BRASSERIES ET DISTILLERIES
- CORPS DE MÉTIER: ATELIER DU FORGERON
- CABINET DE L'APOTHICAIRE
- CORPS DE MÉTIER: TRAVAIL DU CUIR
- RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES : LES AUGUSTINES DE QUÉBEC
- OUTILLAGE EN OS
- CONTENANTS DE CONDIMENTS
- CORPS DE MÉTIER: ATELIER DU POTIER ET DU PIPIER
- QUINCAILLERIE D'ARCHITECTURE
- LA CÉRAMIQUE DU XIXe SIÈCLE À HEDLEY LODGE
- LES CAMPS DE BUCHERONS
- LE POSTE DE LA REINE
- LE PREMIER MARCHÉ SAINTE_ANNE (1834-1844)
- LA TAILLE DE LA PIERRE
- EN COULISSE
-
- À PROPOS
- PLAN DU SITE

Bague dite « jésuite ». Face

Photo : Hendrik Van Gijseghem 2018, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
Bague dite « jésuite ». Vue générale

Photo : Hendrik Van Gijseghem 2018, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal


LOCALISATION
PROVENANCE ARCHÉOLOGIQUE+
Provenance archéologique
BjFj-18 > Opération 11 > Sous-opération E > Lot 22 > Numéro de catalogue 530
Contexte(s) archéologique(s)
Domestique
Fosse
Militaire
Redoute
Région administrative
Montréal
MRC
Montréal
Municipalité
Montréal
Fonction du site
institutionnelle
religieuse
domestique
agricole
ÉVALUATION D'INVENTAIRE+
La bague dite « jésuite » fait partie de la collection archéologique de référence du Québec parce qu'elle est représentative du type stylistique « monogramme marial », un décor qui se présente sous de nombreuses variantes et dont la qualité d'exécution varie considérablement à travers le nord-est américain.
SYNTHÈSES ET RÉFÉRENCES+
Synthèse historique
La bague dite « jésuite » est un modèle de bague estampée-assemblée. Importé de France, ce modèle aurait été embarqué à Rochefort, une base navale active dès sa construction en 1666. Le port militaire est approvisionné par les centres de production de l'Angoumois, de l'Aunis, de la Dordogne, de la Saintonge et du Limousin. C'est par là que transite la plus grande partie des objets offerts aux Autochtones en guise de présents diplomatiques. Les navires en partance de Rochefort assurent la surveillance et la défense de la Nouvelle-France, en plus de ravitailler les membres de l'administration coloniale, les troupes royales et les divers chantiers royaux.
La mise en forme de la bague combine plusieurs techniques pour fabriquer la plaque et l'anneau, puis pour les assembler. La fabrication de la plaque débute par la mise en forme au marteau d'une petite masse de métal, appelée flan. Une fois amené à la dimension souhaitée, le flan est placé dans une matrice, nommée étampe. Il s'agit d'un moule en métal qui comporte en creux la forme et le décor de la pièce à produire. Le métal est ensuite frappé pour prendre l'empreinte de la matrice, soit à l'aide d'un marteau, soit à l'aide d'une machine (balancier ou mouton). Cette technique donne simultanément à la plaque une forme ovale et un décor estampé en relief.
Le décor de cet artéfact, le monogramme marial, possède une connotation religieuse ou magico-religieuse. La Vierge est une figure importante de la religion catholique des XVIIe et XVIIIe siècles. Considérée comme la médiatrice par excellence pour accéder au Christ et à Dieu, elle est présentée aux fidèles comme la nouvelle Ève, qui a lavé le péché originel en mettant au monde Jésus. La piété populaire trouve en Marie la plus puissante des protectrices en raison de son lien privilégié avec Dieu et Jésus. Elle est plus particulièrement associée à la protection de l'enfance et de la maternité. La tradition en fait une véritable déesse de fertilité que les femmes implorent pour obtenir la grâce d'être mère. En signe de dévotion, nombreuses sont les femmes qui portent sur elles des objets religieux et des bijoux ornés du monogramme marial. Plusieurs le font aussi pour s'attirer ses bonnes grâces durant leur grossesse et leur accouchement.
En Nouvelle-France, la bague dite « jésuite » est un objet de parure porté à la fois par les Français et les Autochtones. Elle joue également un rôle important dans les relations franco-autochtones.
Cette bague est mise au jour en 2005 sur le site du séminaire Saint-Sulpice, dans le Vieux-Montréal. Elle provient d'une fosse à déchets se trouvant à proximité d'une redoute (1654-vers 1684), localisée au-dessus du coteau Saint-Louis, sur la terre de Nicolas Godé fils. L'ouvrage défensif, érigé en 1654 sous les ordres de Maisonneuve, vise à améliorer la défense des habitants de Ville-Marie, en proie à la menace iroquoise. La famille Godé y aurait résidé. La bague dite « jésuite » fait son apparition sur les sites archéologiques nord-américains après 1660 et perdure jusque vers 1730.
La mise en forme de la bague combine plusieurs techniques pour fabriquer la plaque et l'anneau, puis pour les assembler. La fabrication de la plaque débute par la mise en forme au marteau d'une petite masse de métal, appelée flan. Une fois amené à la dimension souhaitée, le flan est placé dans une matrice, nommée étampe. Il s'agit d'un moule en métal qui comporte en creux la forme et le décor de la pièce à produire. Le métal est ensuite frappé pour prendre l'empreinte de la matrice, soit à l'aide d'un marteau, soit à l'aide d'une machine (balancier ou mouton). Cette technique donne simultanément à la plaque une forme ovale et un décor estampé en relief.
Le décor de cet artéfact, le monogramme marial, possède une connotation religieuse ou magico-religieuse. La Vierge est une figure importante de la religion catholique des XVIIe et XVIIIe siècles. Considérée comme la médiatrice par excellence pour accéder au Christ et à Dieu, elle est présentée aux fidèles comme la nouvelle Ève, qui a lavé le péché originel en mettant au monde Jésus. La piété populaire trouve en Marie la plus puissante des protectrices en raison de son lien privilégié avec Dieu et Jésus. Elle est plus particulièrement associée à la protection de l'enfance et de la maternité. La tradition en fait une véritable déesse de fertilité que les femmes implorent pour obtenir la grâce d'être mère. En signe de dévotion, nombreuses sont les femmes qui portent sur elles des objets religieux et des bijoux ornés du monogramme marial. Plusieurs le font aussi pour s'attirer ses bonnes grâces durant leur grossesse et leur accouchement.
En Nouvelle-France, la bague dite « jésuite » est un objet de parure porté à la fois par les Français et les Autochtones. Elle joue également un rôle important dans les relations franco-autochtones.
Cette bague est mise au jour en 2005 sur le site du séminaire Saint-Sulpice, dans le Vieux-Montréal. Elle provient d'une fosse à déchets se trouvant à proximité d'une redoute (1654-vers 1684), localisée au-dessus du coteau Saint-Louis, sur la terre de Nicolas Godé fils. L'ouvrage défensif, érigé en 1654 sous les ordres de Maisonneuve, vise à améliorer la défense des habitants de Ville-Marie, en proie à la menace iroquoise. La famille Godé y aurait résidé. La bague dite « jésuite » fait son apparition sur les sites archéologiques nord-américains après 1660 et perdure jusque vers 1730.
RÉFÉRENCES
MERCIER, Caroline. Bijoux de pacotille ou objets de piété? : les bagues dites « jésuites » revisitées à partir des collections archéologiques du Québec. Cahiers d'archéologie du CÉLAT, 34. Québec, Célat, 2012. 234 p.
VOIR LA FICHE DU RÉPERTOIRE DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC 210436 

Bague dite « jésuite »
IDENTIFICATION+
Autre(s) nom(s)
Bague à plaque dite « jésuite »
Bague de Jésuite
Bague jésuite
Numéro(s)
Numéro archéologique : BjFj-18-11E22-530
Autres numéros
Numéro précédent : BjFj-18-11E22-51
Matériaux
Métal - métaux et alliages cuivreux
Classification(s)
Objets personnels > Parure
Lieu(x) de production
Europe > France
Dimensions
Hauteur, Plaque (Mesurée / intégral) : 1,1 cm
Hauteur intérieure, Anneau (Mesurée / intégral) : 1,6 cm
Largeur, Plaque (Mesurée / intégral) : 1 cm
Largeur intérieure, Anneau (Mesurée / intégral) : 1,7 cm
Technique(s) de fabrication :
Brasure
Courbé
Martelé
Inscription(s)
Sur la plaque : M (et) M (ou V) (superposées )
Technique de décoration
Estampé
Motif décoratif
Végétal
Préhistoire/Histoire
historique
Dates
Contexte archéologique : 1654 - avant 1685
Typologie : après 1660 - avant 1730
Découverte : 2005
DESCRIPTION+
Description
La bague dite « jésuite » est un objet de parure en usage entre le troisième quart du XVIIe siècle et le premier tiers du XVIIIe siècle. Elle est en alliage cuivreux. L'anneau, légèrement déformé, mesure 1,60 cm de hauteur intérieure sur 1,70 cm de largeur intérieure. La plaque ovale, légèrement altérée, est ornée d'un décor représentant un monogramme marial formé des lettres « M » et « M » ou bien « M » et « V » superposées.
Type de fabrication
Artisanal
Représentation iconographique
Monogramme marial
Intégrité
Objet entier (100% de l'objet)
Nombre de biens
1
LIEU DE CONSERVATION+
NOM DE L'ORGANISME
Collection des Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal